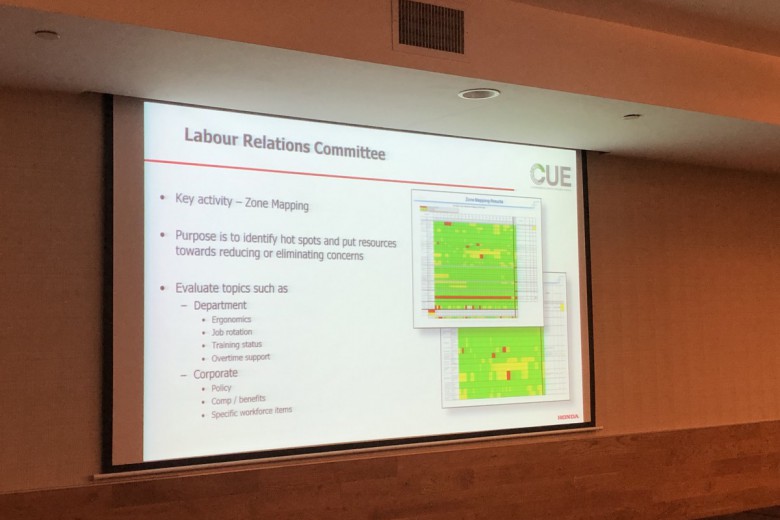Vanessa Ortiz a eu des sueurs froides quand un homme blanc muni d’une arme de poing s’est avancé vers elle.
Ce matin-là, elle s’était levée à 5 h 45 et avait quitté, avant le lever du soleil, sa maison située dans une petite ville en banlieue de Calgary. Professeure d’espagnol au secondaire, elle avait demandé un jour de congé pour aller reconduire des travailleuses agricoles à leur rendez-vous de vaccination prévu à 10 h.
Alors enceinte de sept mois, Mme Ortiz était à une semaine de prendre son congé de maternité. Elle avait senti son dos et ses pieds douloureux alors qu’elle s’était engouffrée dans son auto. Son mari et elle avaient décidé de remplacer leur petite voiture pour un VUS — un choix guidé par leur désir de poursuivre leur travail avec l’Association des Mexicain∙e∙s à Calgary (AMexCal), un groupe de défense des droits des personnes migrantes.
Mme Ortiz et son mari savent que l’Alberta rurale est loin d’être sécuritaire pour une femme racisée, et elle lui avait promis qu’elle n’irait pas seule. Il n’avait pas réussi à prendre congé de son emploi à temps plein en finances pour l’accompagner, mais une travailleuse sociale blanche, sympathique à leur cause, attendait Mme Ortiz devant l’habitation des travailleuses.
Ces dernières vivaient de l’autre côté de Calgary. Pour s’y rendre, Vanessa Ortiz s’en était tenue à l’autoroute afin d’éviter les embouteillages matinaux en ville. À la vue d’une grande maison de campagne rouge en retrait de la route, elle s’était stationnée un peu après l’entrée pour vérifier l’adresse sur son téléphone.
Quand un homme blanc s’est approché d’elle, une arme de poing coincée dans sa ceinture, elle a fait un signe de la main pour indiquer « oubliez ça! » et a roulé 200 mètres plus loin pour rejoindre la travailleuse sociale. Cette dernière l’attendait devant la petite maison blanche où logeaient les travailleuses. L’habitation était bien cachée, tout au bout d’un étroit et sinueux chemin éloigné de la route principale. Son cœur s’est mis à battre la chamade quand elle a vu que l’homme à l’arme à feu la suivait.
« Qu’est-ce que je fais ici? », s’est-elle alors demandé. « Pourquoi est-ce que je mets mon bébé en danger? »
Elle s’est retenue d’appeler son mari, par crainte de l’inquiéter. Elle s’est alors rappelé les travailleuses, certaines partageant une petite chambre à quatre, d’autres vivant dans un garage reconverti. Elle s’est rappelé la longue discussion de 45 minutes avec leur patron pour le convaincre du droit des travailleuses à se faire vacciner. Il l’avait accusée de faire une campagne provaccin.
« Je suis ici parce que ces femmes méritent l’accès aux soins de santé », a-t-elle conclu. Elle s’est stationnée dans l’entrée avoisinante. L’homme armé a sorti son téléphone. À la vue de la travailleuse sociale blanche, Mme Ortiz a alors su qu’elle était hors de danger. Elle était également soulagée que le patron soit au courant de sa venue; dans le cas contraire, elle n’était pas certaine de ce qui aurait pu arriver.
Les femmes sont sorties et n’ont pas paru étonnées de la présence de l’homme et de son arme à feu.
Ces femmes travaillent à la production de fleurs dans une serre. Elles sont venues au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers, qui « permet aux employeurs d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires (TET), et ce, lorsque des Canadiens et des résidents permanents ne sont pas disponibles ».
Leur situation n’est pas rare. En 2020, plus de 80 000 personnes sont arrivées au Canada avec un permis de travail temporaire fermé. Plus du tiers d’entre elles venaient du Mexique. La grande majorité a travaillé en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta. D’ordinaire, les employeurs fournissent un logement près du lieu de travail.
En d’autres termes, le permis de travail, l’hébergement et le statut migratoire de ces femmes sont entièrement liés à leur patron. Cinq travailleuses avaient confirmé vouloir aller se faire vacciner. Mais leur patron leur a dit que la vaccination n’était pas nécessaire. Résultat : seules deux d’entre elles ont finalement accompagné Vanessa Ortiz ce jour-là.
« Il nous surveille tout le temps », ont-elles expliqué à Mme Ortiz en désignant l’homme armé. Il s’agit en fait d’un voisin qui tient le rôle d’un agent de sécurité bénévole. Il patrouille dans les abords de la propriété avec son arme et appelle le patron dès qu’une travailleuse sort de la maison.
La violence raciste n’est qu’un obstacle supplémentaire à la mobilisation des travailleuses et travailleurs migrant∙e∙s en zone rurale.
La première épreuve est de les trouver.

—
Il faut disposer de beaucoup de temps pour entrer en contact avec les travailleuses et travailleurs migrant∙e∙s.
Bien que certains groupes de la base réussissent à payer un peu de personnel, une grande partie de l’organisation communautaire en droits des personnes migrantes est effectuée par des bénévoles qui offrent du soutien durant leurs jours de congé.
Ce travail prend parfois la forme de se promener devant des supermarchés en milieu rural, de flâner dans les allées près des aliments d’Amérique latine et d’attendre qu’une occasion se présente pour entamer la conversation avec des travailleuses ou travailleurs migrant∙e∙s qui achètent des produits leur rappelant leur pays natal. Les organisatrices et organisateurs communautaires offrent également de l’aide en espagnol pour comprendre la paperasse bureaucratique, rarement disponible dans la langue maternelle du personnel migrant.
D’autres arpentent les centres commerciaux près des succursales de Western Union, dans l’espoir de rencontrer des travailleuses ou travailleurs qui envoient de l’argent à leur famille.
Pendant leur temps libre, les organisatrices et organisateurs parcourent des zones rurales en voiture, à l’affût de petites exploitations agricoles, dans des régions où il n’y a souvent même pas de pharmacie.
D’autres encore font de l’autocueillette de fraises en espérant pouvoir discuter avec le personnel migrant du champ d’à-côté.
Les groupes de défense de droits décrivent les besoins criants que les personnes migrantes leur expriment une fois les présentations faites. Un torrent de questions se déclenche : comment puis-je faire venir ma famille ici? Comment puis-je avoir accès à la résidence permanente? Quoi faire en cas de harcèlement au travail?
Cet isolement exacerbe l’autre obstacle à la mobilisation : le contrôle exercé par l’employeur.

—
« C’est un régime de terreur. »
Elizabeth Muñoz travaille trois jours par semaine à l’entretien ménager de l’hôpital de Chicoutimi. Le reste de son temps, elle le dédie comme bénévole à la division du Saguenay du Centre des travailleurs et travailleuses immigrant∙e∙s (CTI). Anciennement directrice d’orphelinat, elle a étudié en sociologie au Mexique et elle s’est spécialisée en développement communautaire. Elle œuvre auprès des travailleuses et travailleurs migrant∙e∙s depuis 2013.
« La première problématique est vraiment, vraiment l’isolement », explique-t-elle. « Il faut comprendre toute l’ampleur de ce mot. »
Au Saguenay, la main-d’œuvre migrante est isolée dans des régions rurales. On amène les personnes directement à la ferme depuis l’aéroport et, dans beaucoup de cas, l’employeur ne leur permet de sortir qu’une fois par semaine pour aller faire l’épicerie. Mme Muñoz explique que le personnel migrant fait face à un double isolement : « isol[é∙e∙]s et enferm[é∙e∙]s dans les fermes et isol[é∙e∙]s dans leurs têtes. »
Selon Mme Muñoz, la pandémie sert d’« argument de terreur » pour la partie patronale. Elle devient une excuse pour resserrer son emprise sur ses employé∙e∙s en leur interdisant de sortir durant leur temps libre.
« Elles [et ils] ne sont même pas capables de gérer leur disponibilité dans leur journée de congé », dit-elle. « La surveillance accrue [des] travailleuses [et travailleurs] permet [au] propriétaire de gérer à 100 % [leur] vie […]. »
L’organisatrice communautaire raconte qu’une travailleuse qu’elle connaît a raté le bus qui devait la ramener à la ferme, après une sortie au centre commercial en ville. Elle a appelé Mme Muñoz en panique, inquiète d’être renvoyée. Quand il a constaté que la travailleuse n’était pas rentrée avec ses collègues, l’employeur était furieux. Après être allé la chercher pour la ramener à la ferme, il a menacé de la renvoyer au Mexique.
« Une travailleuse agricole écoute cette menace dix fois pendant une journée de travail. [Dans les serres, elles se font dire : ]"si tu ne récoltes pas bien les concombres, tu vas être déportée dans ton pays." Le propriétaire a l’idée que les [travailleuses et] travailleurs sont sa propriété, que chaque [travailleuse ou] travailleur agricole [lui] appartient. »
—
Malgré les épreuves, il y a certaines victoires durement gagnées.
Un travailleur tunisien aidé par Mme Muñoz a été forcé de travailler avec de la machinerie lourde, alors qu’il avait été initialement embauché pour faire de la charpenterie. Cette réaffectation illégale lui a occasionné des blessures au dos. Alors que les blessures empiraient, l’employeur a plutôt ordonné au travailleur de dire au médecin que tout allait bien.
Le médecin a donc consolidé le dossier de cet employé auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). La consolidation est un terme technique de la CNESST qui désigne la « [g]uérison ou stabilisation d’une lésion professionnelle […] à la suite de laquelle aucune amélioration n’est prévisible quant à l’état de santé de la travailleuse ou du travailleur ».
À son retour au travail, le travailleur a été reçu par les ressources humaines avec un billet d’avion pour le vendredi suivant. Mme Muñoz a déniché un avocat et a réussi à assurer à ce travailleur les soins de santé nécessaires, en plus de mettre sur pause sa déportation.
Selon elle, la main-d’œuvre migrante qui se blesse au travail est pratiquement « jeté[e] à la poubelle ».
Dans une autre situation, Elisabeth Muñoz a fait usage de l’éducation populaire pour donner aux travailleuses et travailleurs les outils pour défendre leurs droits.
Des Guatémaltèques travaillant dans une serre de tomates vivaient du harcèlement psychologique de la part d’un collègue désigné par l’employeur pour les surveiller dans leur logement. À plusieurs reprises, le collègue a éteint le chauffage dans la nuit et coupé l’eau chaude alors que des gens se lavaient.
L’organisatrice communautaire a donc rencontré en personne ce groupe pour lui donner des ateliers sur les normes du travail provinciales et fédérales, en s’attardant particulièrement au harcèlement.
Armé∙e∙s de leurs nouvelles connaissances, les membres du groupe ont finalement désigné un porte-parole pour confronter l’employeur.
Ce dernier a immédiatement mis fin au système de surveillance et son attitude envers le groupe a changé drastiquement.

—
Dans une exploitation de bleuets, là où la rivière Fraser rejoint les montagnes, pas très loin de la région de Vancouver, une caravane de trois véhicules décorés de ballons apportait avec elle un cadeau inattendu pour la fête des Pères de 2021.
Une camionnette a déversé une bande de musiciennes et musiciens, s’accompagnant d’un accordéon, d’une basse, d’une guitare, d’une clarinette et de congas. Un autre véhicule transportait notamment un chanteur de mariachi et un activiste charismatique vêtu d’un chapeau de cowboy rouge à l’effigie de la fête du Canada, sur lequel un autocollant de colibri en cachait le drapeau unifolié. L’activiste enthousiaste offrait en tirage des petits prix issus de dons, comme des bouteilles d’eau et des casquettes de baseball.
Du dernier véhicule sont émergé∙e∙s encore plus d’organisatrices et organisateurs communautaires qui se mirent à l’œuvre en distribuant des sacs de friandises, des billets de tirage et des dépliants avec leurs coordonnées. Une bannière disait « Bonne fête des Pères »; une autre, « Migrant∙e∙s uni∙e∙s, patrons démolis ».
« Nous étions une caravane festive », se rappelle Gil Aguilar, activiste et fondateur de Fuerza Migrante, un groupe de défense des personnes migrantes basé en Colombie-Britannique.
Avant la pandémie, le collectif avait organisé une célébration pour la fête des Pères dans ses bureaux et avait invité des migrant∙e∙s travaillant dans des exploitations agricoles de toute la région, afin de partager repas et musique. Cette fête s’est appelée #diadelpadremigrante, ou fête des parents migrant∙e∙s. Plusieurs travailleuses et travailleurs migrant∙e∙s au Canada passent des mois sans voir leurs enfants, mais il n’en demeure pas moins que leur rôle de parent fait partie intégrante de leur identité.
« Nous avons décidé que si la main-d’œuvre migrante ne peut venir à nous [à cause de la pandémie], nous apporterons la fête jusqu’à elle. »
En 2020, le groupe d’activistes a passé la fin de semaine à visiter les fermes une par une, équipé d’une machine à karaoké et accompagné de mariachis. En 2021, le collectif a surenchéri en ajoutant un groupe de musique, sillonnant la région environnante de Vancouver durant deux fins de semaine afin de rejoindre le plus d’exploitations agricoles possible.
Bien que la région soit magnifique, les travailleuses et travailleurs « n’ont pas vraiment la chance d’en profiter », selon M. Aguilar. « Ce que ces personnes migrantes voient surtout, c’est la ferme, l’épicerie, la ferme, encore l’épicerie, puis l’aéroport. »
Bien que la végétation luxuriante et les majestueuses chaînes de montagnes soient la particularité des exploitations agricoles de la Colombie-Britannique, l’ensemble du personnel migrant qui fait pousser les fruits et légumes au Canada vit le même genre de relation avec la partie patronale, peu importe le paysage.
« Leur employeur n’est pas seulement leur employeur », ajoute M. Aguilar. « Il est aussi le propriétaire de leur logement, il contrôle leur situation migratoire, il contrôle leur temps libre. La plupart des patrons ont toutes ces règles leur interdisant de fumer, de boire ou de recevoir de la visite. Le personnel migrant est très contrôlé. C’est une situation assez terrible. »
La caravane de la fête des Pères a suscité des réactions presque entièrement positives : les travailleuses et travailleurs sortaient leur téléphone pour filmer l’événement et s’approchaient de l’équipe organisatrice pour la remercier d’avoir pensé à elles et eux.
À quelques occasions, cependant, les festivités ont été abruptement interrompues parce que les patrons, alertés par la musique, commençaient à questionner leurs employé∙e∙s.
« Ça tue l’ambiance dès qu’ils se pointent. Ça installe la peur », raconte M. Aguilar.
À la suite de ces caravanes, des messages WhatsApp de plusieurs nouvelles personnes travailleuses se sont mis à affluer afin de remercier l’équipe pour le spectacle. La motivation première de cette tournée de la fête des Pères n’était pourtant pas de se faire connaître auprès de nouvelles personnes.
« Pour nous, la plus belle récompense, c’est quand les personnes travailleuses migrantes sentent que notre présence n’est pas seulement reliée à [toutes les mauvaises choses] », explique Gil Aguilar. « Nous ne voulons pas les voir seulement comme une force de travail et être en relation avec elles et eux uniquement pour dire : "Vos droits sont bafoués, défendez-vous!". Nous voulons surtout leur dire : "Vous êtes des êtres complexes dont la vie est composée de beaucoup d’autres choses que le travail." »
Les personnes travailleuses migrantes font face à de nombreux obstacles à la défense de leurs droits : elles courent le risque de perdre leur salaire, leur statut migratoire et leur logement. Le permis de travail fermé qui les lie entièrement à leur employeur rend leur emploi précaire.
Mais les organisatrices et organisateurs communautaires ne baissent pas les bras.
« Les médias se concentrent tellement sur les mauvaises expériences, sur l’impuissance », ajoute M. Aguilar. « Mais on ne ferait pas tout ce travail si nous n’avions pas la conviction que nous pouvons changer les choses, s’il n’y avait pas tant de choses qui nous donnent de l’espoir. »
Traduction par Coop l’Argot.